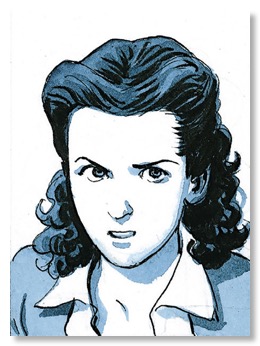Le chemin barré
Il avait son ascendance en horreur; pourquoi n'avait-il pas le droit d'être comme les autres Allemands ? Il se serait mis en rang et sentait déjà les bords de la culotte courte sur ses cuisses nues. Il sentait la tension qu'il y aurait eu en lui lors des sorties au plus profond des grandes forêts. Il aurait dormi sous la tente. Tout cet avenir qu'il portait en lui se développait sans lui, chaque seconde en demeurait nulle et non avenue. Ce qui aurait dû être restait manqué, entassé et inaccompli. Enrôlé dans un groupe, il n'aurait plus eu besoin de se chercher, mais maintenant, il était sans attache et ne pouvait se projeter dans aucun futur. Il savait qu'il était interdit de séjour et pourtant il n'en ressentait rien au fond de lui-même.
Le chemin barré – p. 30
Morvan Jean-David, Riffaud Madeleine, Bertail Dominique, Les nouilles à la tomate. Aire Libre, Editions Dupuis, 2024.
Les témoignages des authentiques résistant·e·s sont particulièrement précieux alors qu'une certaine confusion entre les faits et les opinions se répand. La nécessité de la Résistance, Madeleine Riffaud l'a aussi vécue. Un combat qu'elle a poursuivi dans son engagement pour dénoncer la politique colonialiste. Une attitude qui lui vaut d'être considérée en héroïne pour son action pendant la guerre. Ses combats ultérieurs sont pourtant passés sous silence lors de l'hommage officiel rendu à son décès en 2024, à 100 ans.
Site de l'éditeur
Le parcours des frères Goldschmidt, Alfred Erich et Jürgen Arthur illustre les conséquences d'une politique discriminatoire. De parents nés juifs, éduqués dans le protestantisme luthérien et devenus catholique dans leur pays d'accueil, Erich et Georges Arthur sont marqués par cette ascendance qu'ils assument douloureusement et dont ils ne portent même pas le stigmate de la circoncision. Envoyés en Italie en 1938, puis scolarisés en France l'année suivante, ils s'y engageront, l'aîné dans l'armée et le cadet dans l'enseignement et la littérature.
Malgré ce commun engagement au service de la France, c'est un abîme qui différencie les deux frères. Dans ce Roman du frère, pour reprendre le sous-titre, Georges-Arthur évoque le profond désir de son aîné de s'effacer. Leur père Arthur est écarté de la magistrature en raison de sa naissance juive; une situation qui les ostracise pendant leur scolarité. Puis, la décision parentale de les exiler, prive Erich de son aspiration à être un Allemand exemplaire et à se fondre dans la masse.
L'entrevue de Montoire [du 24 octobre 1940, entre Pétain et Hitler] modifia tout d'un coup l'attitude de ces Français encore hésitants, ceux qui avaient cru que Pétain essayait de jouer au plus fin avec les Allemands. À partir de cet instant, plus de doute possible : Pétain avait trahi et vendu la France aux Allemands et la Résistance devenait une nécessité, un devoir dont chacun devait prendre sa part, s'il le pouvait.p. 43
Ce chemin barré, Erich choisit l'engagement dans la Résistance et l'uniforme militaire qui lui permet de se fondre dans un corps constitué. À l'évidence, il ne se retrouvera pas du même bord que Madeleine Riffaud en Indochine ou en Algérie. La tache que constitue le judaïsme de ses ascendants devrait être lavée par sa perfection.
Il était parvenu exactement à ce qu'il redoutait le plus : être redevable de quelque chose à quelqu'un.
Redevable, il l'était depuis le 18 mai 1938, il ne dépendait plus de ses parents mais d'étrangers qui auraient tout aussi bien pu se charger de tout autres enfants ou ne s'occuper de personne.Le chemin barré – p. 82-83
Jürgen-Arthur, quant à lui, se complaît dans les sévices corporels, alors courants dans les internats. Sa jouissance sublime la honte de ce châtiment public qu'il conçoit peut-être comme la conséquence de l'infamie de sa naissance.
Dans ce roman, écrit à 93 ans, Georges-Arthur Goldschmidt imagine la répulsion de son frère pour lui cet enfant exhibé sans pudeur. Deux portraits qui expriment l'impossibilité de se distancier du Juif : C'était tout de même merveilleusement confortable de ne pas en être un. Sans parler du confort que vous procure l'antisémitisme.
Isaure Hiace pour Le Temps
Site de l'éditeur