L'opposé de la blancheur
Dans un monde chaotique, dominé par la binarité, l'éditeur ose suggérer graphiquement une réflexion en noir et blanc. Une provocation qu'il souligne en évoquant un problème blanc.
Née au Cameroun en 1973, l'autrice a étudié et longuement vécu en France, avant de retourner vivre au Togo, il y a cinq ans. Spécialiste en littérature américaine, elle est une observatrice subtile de la place laissée aux Afrodescendants dans la culture occidentale. Un regard affuté qui la légitime à dénoncer le manque de reconnaissance des Subsahariens en France et à incriminer un excès de victimisation des sociétés africaines.
Ce que la France actuelle, très sécularisée, a conservé de l'époque où elle se faisait l'obligation d'évangéliser les sauvages, c'est la certitude de détenir des vérités révélées. Il faut alors la suivre dans tous ses revirements, ce que les Subsahariens du XXIe siècle ne sont pas pressés de faire, et leur réticence se montrera parfois fanatique.
p. 87
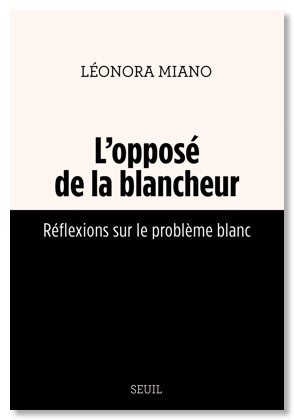
L'autrice place aussi le lecteur face à ses contradictions. Un vecteur important du colonialisme a été la politique missionnaire, souvent protestante. Dans un environnement, par essence raciste, la conversion au christianisme était vue comme une œuvre civilisatrice. Elle a entraîné le changement des modèles éducatif et sanitaire. La religion imposait un nouveau système de valeur nécessitant une réorganisation de la société, alors même que les prémices de la sécularisation opéraient en Europe. Lorsqu'il s'agit de considérer l'implication de la Suisse dans l'économie esclavagiste, la question morale – et religieuse – est également centrale, comme le rappelle la récente série thématique que la RTS (voir encadré). Tant les “esclavagistes” que les abolitionnistes trouvant dans la Bible leur argumentaire. Après avoir imposé les valeurs chrétiennes à l'Afrique subsaharienne, l'Occident capitaliste lui reproche d'y rester attachée et de rejeter la libération des mœurs. Une réticence qu'exploite habilement les régimes autocratiques chinois et russe, notamment dans les pays du Sahel. Les références culturelles dès les années 1950 évoluent rapidement, ce que l'autrice met en évidence par l'analyse de quelques films et séries télévisées. L'American Way of Life crée un imaginaire puissant rendant le modèle capitaliste libéral attractif. Les majors de Hollywood distinguent le bon Blanc du méchant inféodé aux Soviets. Bien que séduits par le discours conservateur sur les mœurs et une résistance à l'hégémonie occidentale, la plupart des Subsahariens restent subjugués par les produits occidentaux.Pourtant, les Français originaires de ces vieilles colonies n'occupent pas, dans les représentations que se donne le pays de lui-même, de son histoire et de sa culture, une place équivalente à celle des Africains Américains aux États-Unis. Bien des éléments pourraient expliquer cette situation sans la justifier, le premier étant le fait que le territoire éclaté de la France a produit des vécus souvent séparés, quand l'histoire africaine américaine s'est en permanence écrite dans celle des autres habitants du pays et inversement. La France put feindre l'oubli quand les États-Unis, où tous hormis les Amérindiens doivent leur présence à une migration - consentie ou contrainte -, n'avaient pas ce loisir.
p. 79
Cette hiérarchisation de la blanchité a son pendant parmi les Africains. comme le thématisait Adichie dans son roman Americanah, Les nouveaux immigrants sont perçus comme un danger par les Africains Américains.[ils] savent aussi, bien qu'un peu obscurément pour la plupart d'entre eux, que la couleur de la peau, instrumentalisée pour inventer les races, n'est pas le sujet de fond. Ce qui l'est, c'est une asymétrie symbolique et politique qui déjoue les projets égalitaires de sociétés se voulant progressistes, et met en cause leur prétention à un universel dont elles seraient les meilleures représentantes, les garantes désignées. Et cette asymétrie se rapporte à la blanchité, terme qui, sous ma plume, signifie « occidentalité ».
p. 16-17
La profusion de termes, voire de néologismes, utilisés par Miano pour décrire la diversité des populations mélanodermes, prouve son intention de dépasser un clivage entre Noirs et Blancs et de ne pas réduire la problématique de la diversification des populations à la thématique identitaire.
C'est le brassage des populations. Aujourd'hui, vous vous promenez dans n'importe quelle ville de Suisse. Vous vous asseyez un moment. Vous regardez les gens. C'est le monde entier qui circule sous vos yeux. Il y a 20 ans, c'était pas comme ça.
Moi, quand je suis arrivé à Genève, je suis originaire d'Iran. J'ai été scolarisé dans une classe du primaire. J'avais 7 ans, en 1957. Mais j'étais un Martien. Aujourd'hui, allez dans les classes suisses romandes. Regardez la diversité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous devez partager une histoire avec ces personnes. Ces personnes viennent d'ailleurs. Leur histoire, c'est les Antilles, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est l'Amérique latine. À partir de ce moment-là, des historiens vont être tentés de changer de questionnaire. C'est aussi simple que ça. »
Bouda Etemad, dans l'épisode 8
Site de l'éditeur
Les Midis de culture – Radio France
Rencontre avec l'autrice au Théâtre de Vidy