L'après-exil
Miroir du Roman du frère, le récit autobiographique reprend les années de formation de Georges-Arthur Goldschmidt. S'agissant de son existence propre, l'auteur accentue l'intériorisation du traumatisme de l'exil.
Le temps de la rupture est fait de gestes aussi insignifiants que la fermeture d'une porte, mais dont l'accomplissement reste à jamais gravé dans la mémoire. Souvent il s'accompagne de l'abandon de la langue maternelle. L'exilé et l'idiome de l'enfance vivront alors deux chemins différents. Investi dans l'enseignement de l'allemand, Goldschmidt retrouvera une langue dont il s'est dissocié pour s'intégrer en France.En soi, tout est comme toujours, sauf que l'on constate soudain que l'on emporte sa langue avec soi, qu'on l'a désormais en soi et derrière soi, mais ni autour ni devant soi.
p. 17
À la différence de Le chemin barré, écrit en allemand en 2022 et traduit par ses soins, la traduction de ce texte de 2025 a été assurée par Jean-Yves Masson. Une manière, peut-être, de laisser transcrire par un tiers ce ressenti troublant de « dédoublement linguistique ».
Cette problématique de la langue – langue maternelle, langue administrative ou scolaire, langue de l'intégration – est centrale chez Goldschmidt. Alors que pour son frère l'intégration s'est faite au travers des corps constitués – l'armée française, à défaut d'avoir été admis dans les jeunesses hitlériennes –, c'est en créant un pont entre ses deux langues que Jürgen-Arthur a donné vie à Georges-Arthur. Le français a « fondé sa survie ».
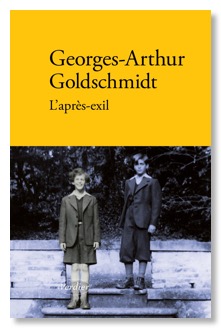
Aucun homme libre ne saurait mesurer ce que peut signifier le passage d'un régime d'oppression et de persécution à la liberté. La dictature use et consume les corps qui ne sont plus assurés de leur équilibre, la dictature dénature tous les mouvements, même les plus élémentaires. Dans l'Allemagne d'alors, chaque geste était un tout petit peu trop intrépide ou un petit peu trop timoré. La dictature avait tout envahi, tout tordu, tout vidé de sa substance.
p. 46
Également évoquée dans le récit jumeau, une certaine continuité des châtiments corporels dans les écoles et internats, d'Allemagne et de France. Cette inclination à la douleur interroge encore le quasi centenaire. Douleur de la fessée qui fait écho à l'humiliation d'être exhibé, mais aussi douleur qui lui permet d'exister malgré la négation prononcée par les décrets nazis. Conséquence du déni de la personne qui subit la construction raciale; assigné à à son ascendance juive, l'auteur est contraint de perpétuer la malédiction qui pèserait sur le peuple juif. Goldschmidt s'étonne que plus de huitante ans après cet exil, sa blessure en reste si vive.
L’exil est la condition de l'être humain, il n'est pas nécessaire d'y revenir, l'exil est aussi la destinée des Juifs, que l'on ne connaît comme tels que voués à l'exil, comme les exilés en soi, comme si l'exil était leur essence; qu'ils le veuillent ou non, ils sont des témoins de l'humanité : on les reconnaît immédiatement comme originaires d'ailleurs, comme ceux qui parlent aussi une autre langue.
p. 80-81
Site de l'éditeur